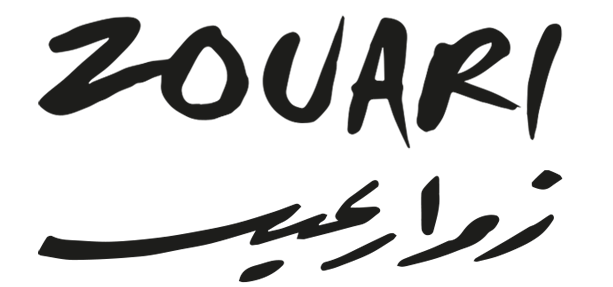Hommage à kélibia
L’horizon est désert, ni plage de sable gis, ni de sable blanc, car je hais la différenciation et aime moins les balises… point de felouques…
point de citadelles, point de forteresses. Pas même un grand furtif sur ton artère obstruée chaque lundi. Et puisque tu m’as façonné en sculpteur-peintre, tu m’as appris à gommer. Alors j’ai rayé et n’ai conservé que le
meilleur, l’humain en toi le dieu de la forteresse, dieu architecte, dieu protecteur. Ton démiurge par qui tout émerge, vers qui tout converge, tel un Apollon marin brave le chaos et Poséidon pour nourrir d’impatientes
bouches affamées…
Depuis Agathocle, depuis Carthage et les romains, ta citadelle n’a cessé de tutoyer l’Histoire et le Temps, depuis les négriers esclaves de l’or, de la guerre et de la flibuste. La voilà aujourd’hui assoupie dans une
brume Hollywoodienne, dans un confus dandysme, une curiosité qui attire encore les foules. Elle est ta gloire. Elle témoigne de tes rares victoires et de tes nombreuses défaites. Nous tous l’affectionnons, nous
tous l’admirons… Moi y compris car à l’image de ma cité ; mes débâcles sont légion.
Kélibia… encore et toujours…
Tu parais, je te fais une révérence par mes lignes libertaires hantées des avatars de mon vécu, par les tendres murmures d’une sculpture bidimensionnelle aux silhouettes diaphanes qui peinent à dissimuler la
flamme ardente des questions originelles qui me taraudent sur le sens du plat et du volume… Ce brasier au voisinage duquel j’ai durci pendant ma tendre jeunesse… j’avais quatorze ans ; le siècle dernier en avait
soixante, un mur d’interdits et de tabous se dressa devant moi. J’appris alors que l’incarnation sculpturale paissait dans les champs de l’illicite et du prohibé… pourquoi cette attirance précoce vers la sculpture ? Les
parois de ma mémoire me renvoient une vision que j’ai contemplée pendant mon enfance. Celle des silhouettes qui jaillissaient des doigts de ma grand-mère Fatima bent el Ghoul et qui atterrissaient sur du velours
et sur la dentelle tendue par un métier à broder… puis il m’est revenu que mon père a l’instar des musulmans de l’Afrique du Nord, était sunnite malékite puritain, et j’ai compris pourquoi mes premières
sculptures ont été enterrées au fond du puits de notre maison dès qu’elles voyaient le jour, avant même que je pusse les admirer accrochées aux flancs de notre patio… La lumière de mes yeux se mêlait ainsi aux
ténèbres du puits, mes larmes à ses eaux C’est là votre sort, sculpturesdévoyées dévoilant la beauté des fées crétoises, des nymphes grecques et des éphèbes d’Alexandre.
Mon père n’y vit qu’une insulte à la pureté ambiante et un casus belli aux portes du royaume ombragé de dieu. Qu’une usurpation, que la sournoise représentation de temps qui ne sont pas nôtres. Alors
conséquent comme il était, Elhadj faisait un autodafé de sculptures : il enterrait en les noyant dans notre puits, ces pubis effrontés, ces fesses callipyges et tout ce que cachent ces seins arrogants de désirs refoulés.
Comme à son habitude, il pouvait résumer le monde dans un regard, un mot, une phrase, et après maints détours il me rappelait-moi ; son fils ainé –la grandeur de la sincérité : « Sois toi-même, ne sois jamais ce que
tu n’es pas ». Je le pleure souvent à chaudes larmes tout en sachant que,là-bas, au couchant il pâtit pour son enfant, qui est encore en moi, qui est défait parce qu’il est « lui-même et jamais ce qu’il n’est pas », dans ce
royaume où Règnent ceux qui ne sont pas ce qu’ils sont.
Un imperceptible souris cajole le souvenir de l’autodafé, ma révolte s’éteint ; je caresse la mémoire d’Elhadj, je m’incline devant la sépulture de ce juste qui attend le paradis. A lui je dédie mes œuvres drapées dans
le souffle de kélibia. Imbibées de ses fragrances. A lui qui m’a transmis cette fantastique alchimie ethnique d’où je puise cet élan créateur. Savait-il qu’en faisant ce qu’il a fait, il a fertilisé
notre terroir ?
Et la sculpture jaillit du puits… en lamelles.
Voici mes sculptures ciselées sous le ciel de Kélibia, pour les unes, sous les antipodes pour les autres. Ce ne sont point des sculptures. Ce sont les tessons de mon âme qui reviennent par myriades dérober
l’ombre et la lumière. Je plains mes œuvres prisonnières de cette dualité. Je sens leur souffrance. Leur douleur coule en moi. Nous rêvons de fondre dans un néant cosmique pour tisser l’écharpe d’Iris, protectrice de
mon enfance.
Voici mes œuvres… des réminiscences pleines de mutisme, pleines d’éloquence, qui s’agitent au son de la guitare de Van Halen et m’invitent pour une dance.
Créateur indigne, j’ai fait maigre chère. J’ai lésiné sur les courbes et les traits. Je les ai privées de bombance et de chair. Et du papier elles sont nées faméliques, pugnaces et libres. Ni même un iota d’espace
illusoire.
Ces sculptures témoigneront que je fus envers elles, grand seigneur,désintéressé et prodigue. Ce sont elles qui témoigneront que les démons du puits n’ont pu chasser les démons de la sculpture ni purifier mes
veines de leur faste pouvoir.
Kélibia…
Ma concubine respectueuse, dépositaire de ma vénération, mémoire de mes peines et de mes angoisses, organe de ma tristesse d’homme réprimé… je te confie ma grand-mère Bint el Ghoul et mon père Hassen.
Je me sublimerai en Nuées qui pleuvront sur vous une ondée d’amour et d’adoration.
Kérkouéne 27 Janvier 2007
Texte traduit par Anouar Lengliz
Le génie de la grâce et l’ange gardien.
Étonnamment la sonnerie de l’école ne retentit point… Aucun son de cloche ne nous parvint ce jour-là, un jour brumeux de novembre de l’année 1963.
Ce n’est qu’un demi-siècle plus tard que je pus m’expliquer le mutisme de l’airain.
Ce jour-là notre pays fut touché par l’onde de choc de l’assassinat de Jhon Kennedy, président des Etats-Unis, pour nous Tunisiens, Kennedy était une icône. N’avait-il pas reçu en grandes pompes, un an
auparavant, notre leader Bourguiba et son épouse Mathilde lors d’une visite historique en l’honneur de notre jeune et moderne République ?
La sonnerie n’avait pas retenti… les instituteurs n’avaient pas rejoint leurs salles de classe. Ils s’étaient agglutinés devant le bureau du directeur et s’étaient mis à faire l’éloge du défunt comme à l’oraison.
Nous étions des enfants d’à peine dix ans. Nous ne comprenons pas ce qu’il se passait. Nous cherchâmes des réponses les uns dans les yeux des autres, un murmure monta. Nous étions partagés entre joie et
étonnement. Les plus âgés s’éparpillèrent dans un brouhaha grandissant. Ils s’adonnèrent avec zèle à leurs jeux favoris : la toupie et les billes (kallout et botchi). Les battants de la porte de l’école ayant rendu
l’âme depuis belle lurette, la cour de récréation, la rue adjacente et l’aire de repos des charretiers de leurs baudets se transformèrent en une vaste pétaudière.
La matinée tirait sur sa fin, l’école se vidait. Aucun élève ne prit la peine de se mettre en rang devant la classe de Madame Bernard, ni devant celle de Anissati Badiâa la Nabeulienne ; même pas devant la salle de
classe de mademoiselle Junot la Suissesse blonde, la belle de l’école !…
La ferveur des élèves épris de leur maitresse s’émoussa sous l’effet de l’interminable attente. Ce jour-là, ils furent privés de la musique de ses talons, des fragrances de son parfum, de sa mini-jupe rouge écarlate et
de ses cuisses moulées dans un collant de dentelle noire.
Nous faisons le guet, mes camarades et moi, devant notre classe dans l’expectative de notre maître Si Amer, si sévère et à la mine patibulaire.
Debout, l’esprit vagabond, je cogitais : la classe s’est dépeuplée, Si Amer viendra-t-il ? Et, à l’intérieure l’immensité du tableau n’attendait que mes papillons, mes animaux, les fleurs de tous les champs et de
toutes les saisons, mes châteaux portés par les nuages, mes étoiles et mes planètes, mes chevaux ailés, mes graciles hirondelles hôtes du toit paternel et mes angelots aux ailes argentines. Tout cela baignant dans
une pureté qui n’a d’égal que la netteté des traits de ma grand-mère Fatma.
Tous attendaient que je me défisse de ma peur, que je franchisse le Rubicon et que j’allasse voguer avec mes créatures au-dessus du tableau de Si Amer. J’ai poussé la porte, j’ai passé la tête par la fente et
je me suis écrié : « le tableau est maculé de blanc ?! ». Le quatuor irréductible envahit la salle et s’acharna sur le tableau du maître pour lui rendre sa noirceur génétique. J’empoignai l’arc-en-ciel macéré dans la
chaux et me jetai à corps perdu dans le sein de l’immensité noire. Les rires de joie, les cris de satisfaction et les implorations des membres de ma troupe fusèrent. Le bas du tableau se remplit. Je dus chevaucher la
chaise de Si Amer pour atteindre le haut… l’instant était magique. Je planais. J’étais maitre du tableau de si Amer et je venais d’en faire un paradis. C’était l’aubaine d’une vie. Une vie de dix printemps et d’un
automne.
Le grincement d’une porte qui s’ouvrait vint achever ce moment de pur bonheur. L’apparition d’une masse grise compacte nous glaça : c’était Si Amer. Il ferma nerveusement la porte et se dirigea vers l’armoire où
logeait sa baguette… une maudite branche d’olivier. Il vociféra :
- – Fils de chien ! vous n’êtes pas rentrés ?
Ces quelques secondes permirent à mes compagnons de s’extirper comme un souffle. Quant à moi, ma confusion et ma frayeur étaient telles que j’en oubliai où j’étais et que je chutai fatalement de la chaise…
En me relevant, je sentis le bâton griller mon dos et ronger mon cou. « Maudit ! Satan ! n’as-tu pas cessé de dessiner ? tu es toujours attaché à cette ignoble habitude ? ». Je me tortillais de douleur et virevoltais pour
échapper à sa baguette infernale qui s’abattait sur moi de toutes parts. « Espèce de chien ! c’est quoi ces créatures qui volent ? ».
De la branche d’olivier fulgurait l’éclair. Le bâton me foudroyait. Ma peau brûlait. « Tends la main droite ! celle qui a dessiné ! ». Et le dard me transperçait. « Retourne-la » … mon cœur battit la chamade de plus
belle, ma salive tarit. Mon cerveau enfantin n’arrivait plus à identifier mes sensations. Je fermais les yeux, j’entendais mes phalanges crépiter. Etaient-elles parties en tesselles ?… Aucun son ne parvint à sortir de ma
gorge, aucune larme ne dévala sur ma joue, aucune prière ne desserra mes lèvres. Quand, entre deux coups, je parvenais à distinguer son visage avec l’espoir d’une miette de miséricorde, je ne voyais qu’un ogre
légendaire. J’étais transi. Seule la tiédeur de mon urine dégoulinant le long de mes jambes maintenait ma conscience.
« Tends la main ! tu ne pleures même pas ! tu es possédé par le diable !
peau de tambour ! ».
J’obtempérais, je tendais les mains. Sans larmes, sans sanglots… puis du fin fond de moi, monta une imprécation : « par les maudites divinités païennes de tes aïeux qui t’ont appris à haïr l’art et par toutes leurs
idoles crépusculaire… jamais tu ne pourras m’anéantir. Je donnerai vie à mes dessins et à mes sculptures tant que la vie me sera donnée ». Subitement, l’entrebâillement de la porte m’invita à l’évasion. Je
m’envolai sur mon cheval blanc ailé comme une brise. Et c’est dans l’ombre tutélaire de la demeure d’Ammi Hmida que mon être revint. Je gémissais, je frémissais de tout mon corps qui fondit en
larmes. Les sanglots se succédaient aux sanglots. Je me tâtais avec angoisse : mes mains existaient-elle encore ? oui ; c’est l’une d’elles qui essuya le sang qui jaillissaient de mon épaule.
Plus tard, à la maison, je fis tout pour les camoufler, pour que ma mère ne fût pas ébranlée dans ses convictions de femme illettrée ; l’instituteur ne doit pas tomber de son piédestal où l’a placé son statut de prophète.
Deux jours durant, je fus incapable de tenir un crayon, d’utiliser une cuillère. Je plongeais les mains dans la jarre d’huile d’olive en espérant qu’elle rachèterait les pêchés du rameau d’olivier.
Strate après strate, les temps me prodiguèrent la thériaque de l’oubli.
Ensuite, pour secouer le sablier, j’ai vaqué à vivre à travers ma peinture et mes sculptures. Cela dura cinq décennies… jusqu’au jour où la providence me fit rencontrer le chauffeur de la camionnette que j’avais
louée pour transporter quelques-unes de mes œuvres à Tunis, dans l’une des galeries de la capitale. Ce matin-là, je pris place à côté du conducteur et me mis à feuilleter un journal dans l’illusoire dessein de
tuer le temps. Quelques minutes plus tard mon voisin balbutia :
- – Vous avez bien de la chance ! lire un journal ou écrire mon nom est le vœu le plus cher de ma vie.
Je le regardai et dis :
- – Mais mon ami, vous êtes jeune. Que vous est-il arrivé ? vous n’avez été touché par le génie de la grâce ? le génie de Bourguiba. N’êtes-vous pas allé à l’école ?
Telle une complainte sa réponse fut :
- – Si… mais la fatalité dans sa cruauté m’a mis entre les mains d’un instituteur maître en fustigation et en torture. Un bourreau.
Mais comme s’il avait pressenti une certaine incrédulité de ma part, il haussa le débit :
- – C’était un fils à papa, issu d’une riche famille citadine propriétaire d’orangerais. Il avait mal digéré son affectation dans une pitoyable école au milieu d’un village perdu peuplé de gueux… A cause de
lui l’école est devenue un enfer aux mille supplices pour y échapper j’ai quitté l’école d’autres élèves m’ont imité.
Sa phrase s’acheva par un long soupir et il se réfugia sous une chape de silence. Une lame de fond me secoua. Je sortis de ma torpeur. Le journal s’envola de mes doigts. Une salive d’interrogations indignées me
vint à la bouche :
- – Qu’est- ce qu’il y avait entre vous deux ? quel était votre crime ? pourquoi avez-vous été le premier à interrompre vos études ?
Il émergea laborieusement :
- – Il m’a pris en grippe parce qu’il m’avait aperçu jouer la flûte à mes brebis et mes chèvres que j’emmenais paître non loin de l’école. Ma flûte fut brisée et écrasée ; et depuis je suis devenu sa tête de
Turc. Il exerça sur moi tous les supplices imaginables. J’ai dû quitter l’école pour sauver ma peau…
Je sentis ma tête s’alourdir. Je l’appuyai sur les paumes des mains. Je regardais dans le vide… mes yeux erraient aux confins de l’azur et de la verdure… soudain surgit un spectre. Le spectre de Si Amer, le monolithe
païen ennemi des arts de l’espace et du temps, ennemi de la civilisation.Ma mémoire vomit ce qu’elle avait refoulé depuis un demi-siècle, depuis le mutisme de la sonnerie de l’école le jour des obsèques de Kennedy.
Des larmes inondèrent mes yeux que je m’efforçai de camoufler. Ma torpeur me reprit. Je fermai les yeux, je revis mon cauchemar… Arrivé à destination, je me sentais complétement lessivé au bord de la nausée. Ce saut de dix lustres dans le temps- et quel temps ! – m’avait éreinté. Je m’adossai au mur contemplant le travail du chauffeur qui déchargeait mes œuvres… c’est alors que rejaillirent les dessins du tableau de S i Amer foisonnant sur mes toiles, papillonnant débordant de peps respirant la vie. Une délectable brise m’enveloppa de félicité : mes dessins et mes penchants graphiques ont vu le jour et ont grandi et les voici présents comme la preuve indéniable que je suis resté cet enfant toujours fasciné par la pureté du trait austère qui me transporte par sa beauté et sa noblesse. J’ai tapoté mon épaule gauche en signe de gratitude envers mon ange gardien qui a cru en moi et qui ne m’a jamais abandonné. C’est lui qui m’a fait oublier ce monstre obscurantiste en enluminant ma voie et en affranchissant mes facultés. Grace à lui j’ai foulé le royaume de la beauté et des arts et j’ai savouré le plaisir de la recherche et de la création. Il m’a béni et m’a aidé à tenir parole.
Je suis là… mes œuvres sont là… mon ange gardien est là… sur l’épaule jusqu’à mon trépas.
Texte traduit par Anouar Lengliz
Mohamed zouari
Kérkouéne en 29 Mars 2016
L’énigme de la glace sans tain
« …Il est difficile d’écrire sur une œuvre picturale. On ne peut guère espérer qu’écrire « à côté ». À côté, c’est-à-dire le près possible du peintre, en suivant son cheminement, en le regardant travailler, évoluer,
vivre son œuvre. Oui, c’est bien ainsi que j’entends le rôle de l’écrivain d’art : plutôt témoin que juge. Une œuvre, c’est d’abord un miroir sans reflet. Il faut, non pas briser le miroir, mais se glisser à l’intérieur comme
dans l’eau d’un lac. Derrière le miroir, se trouve le secret de l’œuvre… » 4
Ainsi donc, l’écrivain d’art est-il tragiquement mis devant une affreuse alternative : s’arroger la stature d’un juge n’ayant aucune légitimité, ou se glisser dans les pas de l’artiste pour cohabiter avec lui
dans sa genèse créatrice. L’objectivation de l’assertion de Ragon ne peut avoir lieu que si le temps culturel a connu une stratification concordante. Mais si le temps culturel est atteint de discordance, comme c’est le cas chez nous, deux obstacles mettront en péril ladite cohabitation. Le premier se dresse devant le témoin, soit parce qu’il est incapable de nager, faute d’avoir effleuré, même par le regard la lame d’un lac, soit parce qu’il est mu par une propension irrépressible à briser les miroirs. Quant au deuxième obstacle, il est l’apanage de l’artiste créateur, tributaire de la preuve testimoniale, et qui peut être lunatique, insaisissable … un feu follet ou peut s’isoler pour se prémunir contre la montre, au point que l’acte créateur, chez lui, demeure une énigme hermétique.
Que l’ombre soit le relief
Trois lustres avant que le XXème siècle ne s’éteignit, les pouces ont commencé à paraitre à la surface de mes œuvres planes. Des poussées nubiles, des velléités sculpturales. Très vite, elles ont phagocyté les cadres de mes tableaux pour leur rendre la liberté, et les travestir en véritable sculptures. Ma plastique tourmentée se glissa dans le relief pour incarner des rôles à lui dévolus. Je ne tolérais plus que mes ombres fussent factices, je voulais qu’elles vibrent au rythme des pulsations du monde, qu’elles s’animent et flattent les yeux. De cette période charnière dans le processus de mon expérience. Je garde des souvenirs délicieux ; je réalisais mes œuvres dans une ambiance nouvelle : réduisant le bidimensionnel, louant le volume, détrônant le pinceau. Mes couleurs, longtemps pâteuse, devinrent fluides. Mes œuvres échappaient à l’emprise du tableau plat en toile de lin religieusement hérité du XIVéme siècle. Cela me permit de mieux me connaitre et de mieux m’accepter. Loin du troupeau, avec ma démarche à moi, avec mes yeux à moi. Pris de vertige, je ne savais plus si je peignais en sculptant ou si sculptais en
peignant. C’est alors que les briseurs de miroir se hâtèrent de dénigrer mes créations en les qualifiant d’œuvre martiennes appartenant à des temps qui ne sont nôtres. D’autres s’interrogèrent : sont-ce l’expression d’un art mur ou d’un art en errance ? ma réponse fut « oui, je peins, je grave, je sculpte, je compose et je colorie. Quelle importance si mes œuvres sont androgynes ? Quelle importance si je m’égarais définitivement ? ce sont les aléas de l’expérimentation. J’ai invité les matériaux et les reliefs à plus de proximité, à plus d’intimité. Ce faisant, j’ai aboli des clivages de classes entre arts nobles et arts vils car, comme dans la vie, je maudis leracisme et je hais l’immobilisme. Et même si certains considéraient mes
œuvres comme « androgynes », cette singularité me conforterait » 5 .
Après un processus long d’un tiers de siècle oscillant entre les fulgurances rebelles nourris par mon intuition et autres moins chanceuses mort-nées et enterrées par la faute d’un environnement néfaste, je garde en moi la sensation de l’expérience culminante et de la géniale métamorphose. Le tout mêlé à un arrière-goût d’amertume née de désillusion et d’injustice. Un arrière-goût qui m’a poussé, à plusieurs reprises, à dresser des buchers dont les fagots n’étaient autres que mes œuvres.
L’expérimentation : Géhenne ou Eden ?
L’expérimentation, l’exploration, la navigation vers l’inconnu ont été le produit d’une autre vision du monde celle de la renaissance, l’occidental contrairement à l’arabe s’est redressé pour atteindre la modernité effective et progressiste. Pour ce faire, il n’a pas hésité à profaner le sacré et à violer les sépultures. Michel Ragon y fait allusion en évoquant le peintre Poliakoff : « …ces couleurs, Poliakoff les pose par couches successives, procédé qui nous ramène à la peinture égyptienne. En effet, lorsqu’il était à Londres, Poliakoff, profitant un jour, de l’inattention d’un gardien a osé gratter de l’ongle l’écaille des sarcophages pour vérifier la superposition des couches de couleur. Un
Sarcophage de la National Gallery (placé maintenant dans un cercueil de verre) montre sans doute une toute petite détérioration de plus, mais notre époque a gagné un grand artiste… » 6
Sisyphe… une muse !
Cette exposition retrace une expérience de plus de trois décennies, une expérience rude comme la vie. J’y ai émigré vers mon zénith par l’esprit, les pieds sur terre. A chaque crue, le fleuve de la vie manquait de me noyer. Je m’apercevais à ces instants que je n’avais pas mis les ailes d’Hermès et que mes pieds touchaient encore la terre. Une si déchirante omission ! Et bien que n’ayant commis aucune profanation, ni sacrilège, je dus subir le même supplice que Sisyphe, mon fardeau étant ma postérité. Je peinais à la hisser vers le crime, elle prenait un malin plaisir à me ramener vers la pente. Pendant les moments de trêve. J’en choisissais quelques œuvres que j’immolais dans les flammes. Une fumée aux nuances de résine montait, l’encens emplissait mes narines. Et le cycle infernal reprenait : ascension, descente, bûchers. Nous avons failli aller vers notre perte mais nous avons su trouver la voie du salut. Néanmoins nous restons persuadés que le spectre du Corinthien à la pierre ne sera jamais bien loin, qu’il se rappellera à nous éternellement, jusqu’à la fin… ma fin…
Texte traduit par Anouar Lengliz
Mohamed zouari
Kérkouéne en 2014
_L’amant de Tanit_
Face au camaïeu de la dive Méditerranée
Le visage rubicond, devant un Magon, nectar sacré
Je confesse à ma mer mère
Mon désarroi, mes secrets
Je bois la lèvre du calice, le vin coule enjoué
« Tanit ! Ashtart de Phénicie.
Aphrodite de Carthage
Je me prosterne devant toi, de ma foi je fais étalage
Romps mon exil, guide ma plume, atténue le présage
Enfourche le dauphin de Poséidon, viens dans mon sillage »
En réponse à ma prière le ressac revint en écho
Comme les psaumes ardents sur les murs de Jéricho
Le sang bourdonne dans mes veines, couleur coquelicot
Inespérée est la parousie o dieux inamicaux
Sa vie c’est son art. son art c’est sa vie
Pour l’éternité il tamise l’existence par sa sensibilité
Et nous offre des pépites perses comme un jubilé
« Pauvre poète tu n’es qu’un mortel même si tu vie vieux
Je suis Tanit la déesse et moi habitons le même haut lieu
Le site punique de Kerkouen béni par les cieux
Mon amant est immortel, c’est un céleste dieu créateur
De ses doigts nait la vie, c’est le démiurge des couleurs.
Il fertilise le monde et y souffle de son ardeur
Deux yeux, des mains, une âme… mais infinies sont splendeurs »
« Qui est donc ce dieu ni de l’olympe ni de panthéon ?
Pour lequel Tanit fait la muse en toute abnégation ? »
« Mon chéri se nomme Zoumed, il a ma bénédiction »
Oui Tanit, ce dieu-là mérite tant la vénération
Zoumed est mon ami, mon frère ; il a tout mon respect.
Poème écrit par Anouar Langliz, dédié a l’artiste.